Démocratie industrielle et Démocratie politique – Le Mouvement socialiste N° 11 – Juin 1899
Cet extrait de Réforme sociale ou révolution?" a été publié dans l'importante revue "Le Mouvement socialiste" en juin 1899, au moment même de sa parution en Allemagne et donc disponible en langue française très précocement. Il est disponible sur le site Gallica sous forme PDF, image et texte. Il était accessible sur le site Bataille socialiste sous sa forme PDF. Comprendre donne accès à sa version texte.
CRITIQUE DE BERNSTEIN(1)
Le socialisme de Bernstein se ramène à faire participer les ouvriers au développement de la richesse sociale et à transformer ainsi les pauvres en riches. Comment cela peut-il s'effectuer? Dans ses articles de la Neue Zeit, intitulés Problèmes du Socialisme, Bernstein ne laissait entrevoir que quelques indications à peine compréhensibles. Mais dans son livre, il nous fournit un éclaircissement complet sur cette question : son socialisme doit être réalisé par deux moyens, par les syndicats, ou selon l'expression qu'il emploie par la démocratie industrielle, et par les coopératives. Par les premiers, il veut s'en prendre au profit industriel ; par les seconds, au profit commercial.
Pour ce qui est des coopératives, et avant tout des coopératives de production, elles représentent, dans leur essence, au milieu de l'économie capitaliste, une forme hybride : une production socialisée en petit, dans un système d'échange capitaliste. Or, dans la société capitaliste, c'est l'échange qui domine la production et, par suite de la concurrence, pose comme condition même de l'existence pour toute entreprise une exploitation brutale, c'est-à-dire une subordination complète du processus de production aux intérêts du capital. En pratique, cela s'exprime par la nécessité de rendre le travail le plus intense possible, de le raccourcir ou de le prolonger selon la situation du marché, d'attirer la force de travail ou de la repousser et la jeter sur le pavé selon les exigences du débouché, en un mot de pratiquer toutes les méthodes connues qui rendent une entreprise capitaliste apte à soutenir la concurrence. Il résulte de ce qui précède que, dans les coopératives de production, les ouvriers se trouvent dans l'obligation contradictoire de se régir eux-mêmes avec tout l'absolutisme inévitable, de jouer par rapport à eux-mêmes le rôle de l'entrepreneur capitaliste. Et c'est précisément par suite de cette contradiction que la coopérative de production doit sombrer. Car, ou bien elle redevient, par un développement régressif, une entreprise capitaliste ; ou bien, si les intérêts ouvriers sont plus forts, elle se dissout.
Ce sont là des faits que Bernstein lui-même constate, mais qu'il comprend mal; car, avec Mme Potter-Web, il voit dans une « discipline » insuffisante la cause de la décadence des coopératives de production. Ce qu'on appelle ainsi « discipline » d'une façon superficielle et plate, ce n'est pas autre chose que le régime absolutiste propre au capital, qu'il est évidemment impossible aux ouvriers de s'appliquer à eux-mêmes.
Il suit de là que la coopérative de production ne peut assurer son existence, au milieu de l'économie capitaliste, que si elle réussit à résoudre par un détour la contradiction — qu'elle porte en elle — entre le mode de production et le mode d'échange, et si elle se soustrait d'une façon artificielle aux lois de la libre concurrence. Elle ne le peut que si elle s'assure à l'avance un débouché, un cercle fixe de consommateurs, — et c'est la coopérative de consommation qui lui en fournit le moyen.
Et c'est là — et non pas dans la distinction entre coopératives d'achat et de vente — que gît ce mystère que cherche à résoudre Bernstein, à savoir pourquoi les coopératives indépendantes de production sombrent et pourquoi c'est seulement une coopérative de consommation qui peut leur assurer la vie.
Mais si c'est ainsi, si les conditions d'existence des coopératives de production sont, dans la société actuelle, liées aux conditions d'existence des coopératives de consommation, il en résulte, comme conséquence ultérieure, que les coopératives de production sont limitées, dans les cas les plus favorables, à un petit marché local restreint, et en sont réduites à la fabrication des choses — peu nombreuses — de consommation immédiate, et surtout à la production des objets de première nécessité. Toutes les branches les plus importantes de la production capitaliste : les industries textile, houillère, métallurgique, du pétrole, de même que la construction des machines, des locomotives, des navires, sont exclues par avance de la coopérative de consommation et par conséquent aussi de la coopérative de production. Donc, même en faisant abstraction de leur caractère hybride, les coopératives de production ne peuvent pas être un instrument de réforme sociale générale, déjà pour cette raison que leur généralisation suppose avant tout la suppression du marché mondial, —la dissolution de l’économie mondiale présente en petits groupes locaux de production et d'échange, c'est-à-dire essentiellement une régression de l'économie capitaliste vers l'économie médiévale.
D'ailleurs, même dans les limites de leur réalisation possible, dans les cadres de la société actuelle, les coopératives de production se réduisent naturellement à de simples appendices de coopératives de consommation, lesquelles, en leur qualité de porteurs principaux de la réforme socialiste poursuivie, montent ainsi au premier plan. Mais si c'est cela, alors toute la réforme socialiste poursuivie au moyen des coopératives cesse d'être une lutte contre le capital de production, c'est-à-dire contre le tronc principal de l'économie capitaliste, pour devenir une lutte contre le capital commercial, et notamment contre le moyen et le petit commerce, c'est-à-dire contre de simples ramifications du tronc capitaliste.
Pour ce qui est des syndicats, qui, eux aussi, représentent, d'après Bernstein, un moyen de lutte contre le capital de production, ils ne sont pas en état— comme nous l'avons démontré d'ailleurs — (2) d'assurer aux ouvriers une influence quelconque sur le processus de production, ni au point de vue de son étendue, ni au point de vue de ses procédés techniques.
Mais pour ce qui est du côté purement économique, « la lutte du taux du salaire contre le taux du profit », comme l'appelle Bernstein, cette lutte ne se produit pas dans l'espace éthéré, mais dans les limites déterminées de la loi des salaires, qu'elle ne peut pas transgresser, qu'elle ne peut que réaliser. Cela devient évident aussi lorsqu'on prend la question à un autre point de vue, et que l'on se demande quelles sont les fonctions propres des syndicats.
Les syndicats auxquels Bernstein assigne le rôle de mener, dans la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière, l'attaque principale contre le taux du profit industriel et de le dissoudre progressivement dans le taux du salaire, ne sont nullement en état d'entreprendre une politique économique offensive contre le profit. Ils ne sont, en effet, que la défensive organisée de là force de travail contre les attaques du profil, qu'un moyen de résistance de la classe ouvrière contre la tendance dépressive de l'économie capitaliste.
D'abord les syndicats ont comme rôle d'influencer sur le marché, par leur organisation, la situation de cette marchandise qu'est la force de travail. Mais cette organisation est continuellement disloquée par le processus de prolétarisation des couches moyennes, qui fait affluer sur le marché du travail des marchandises toujours nouvelles. En second lieu, les syndicats ont pour but d'élever le niveau de la vie, la part de la classe ouvrière à la richesse sociale. Mais cette part est continuellement rabaissée, avec la fatalité d'un processus naturel, par la croissance de la productivité du travail. Pour comprendre cela, on n'a pas du tout besoin d'être marxiste ; il suffit d'avoir eu une fois entre ses mains le Zur Bedeutung der sozialen Frage de Rodbertus.
De cette façon, la lutte syndicale se transforme, dans ses deux fonctions économiques principales, grâce à des processus objectifs de la société capitaliste, en une sorte de travail de Sisyphe. Ce travail de Sisyphe est, il est vrai, inévitable, si l'ouvrier veut arriver à obtenir le taux du salaire qui lui est échu d'après la situation donnée du marché, si la loi capitaliste des salaires doit être réalisée, et si la tendance dépressive du développement économique doit être paralysée, ou plutôt, plus exactement, affaiblie dans son action. Mais lorsqu'on songe à transformer les syndicats en un instrument de réduction progressive du profit au bénéfice du salaire, cela suppose avant tout, comme condition sociale : 1° un arrêt dans la prolétarisation des classes moyennes et dans la croissance de la classe ouvrière; 2° un arrêt dans l'augmentation de la productivité du travail. Donc dans les deux cas, de même que dans l'économie basée sur les coopératives de consommation, c'est une régression vers les formes sociales précapitalistes.
Les deux moyens de Bernstein pour accomplir la réforme socialiste : les coopératives et les syndicats, apparaissent donc comme complètement impuissants à transformer le mode de production capitaliste. A proprement parler, Bernstein en a une conscience obscure. Il ne les considère que comme moyen de rogner le profit capitaliste, et d'enrichir de cette façon les travailleurs. Mais par là même il renonce lui même à la lutte contre la production capitaliste, et oriente le mouvement démocrate socialiste vers la lutte contre la distribution capitaliste. En effet, Bernstein formule, à plusieurs reprises, son socialisme, comme la tendance à une distribution « juste », « plus juste » (page 51 de son livre), même « encore plus juste » (Vorwaerts, 26 mars 1899).
Certes le motif qui pousse le plus immédiatement vers le mouvement démocrate socialiste, au moins dans les masses populaires, est aussi sans contredit la distribution « injuste » de l'ordre capitaliste. Et en luttant pour la socialisation de toute l'économie, la démocratie socialiste tend par cela même aussi à établir une distribution « juste » de la richesse sociale. Seulement, grâce à cette conception marxiste que la distribution n'est à chaque moment que la conséquence naturelle du mode de production donné, elle dirige sa lutte, non pas contre la distribution dans le cadre de la société capitaliste, mais vers l'abolition de la production marchande elle-même. En un mot, la démocratie socialiste veut instaurer la distribution socialiste par la suppression du mode de production capitaliste, tandis que le procédé de Bernstein est juste le contraire. Il veut combattre la distribution capitaliste et espère amener, par cette voie, l'établissement du mode de production socialiste.
Cela étant, quelle base théorique peut-on maintenant donner à la réforme socialiste de Bernstein? Peut-on la fonder sur des tendances déterminées de la production capitaliste? — Nullement. Car, en premier lieu, il nie lui-même ces tendances ; et, en second lieu, d'après ce que nous venons de dire, la forme poursuivie de la production n'est, chez lui, que le résultat et non la cause de la distribution. Le fondement théorique de son socialisme ne peut donc pas être économique. Après avoir renversé de fond en comble les buts et les moyens du socialisme, et par .cela même les rapports économiques, il ne peut plus donner des bases matérialistes à son programme : il est forcé d'avoir recours à un fondement idéaliste.
« Pourquoi déduire le socialisme de la nécessité économique? », s'écrie Bernstein. « Pourquoi dégrader l’intelligence, la conscience du droit, la volonté de l'homme? ». (Vorwaerts, 26 mars 1899). La distribution plus juste de Bernstein sera donc réalisée, grâce à la volonté humaine souveraine n'agissant pas sous l'impulsion de la nécessité économique, ou, plus,exactement, — comme cette volonté n'est elle-même qu'un instrument,— grâce à la conscience de la justice, en un mot grâce à l'idée de la justice.
Nous voici donc arrivés— heureusement —au principe de la Justice, ce vieux cheval de retour, monté depuis des siècles par tous les rénovateurs du monde privés de plus sûrs moyens de locomotion historique, à cette Rossinante déhanchée sur laquelle ont chevauché tous les Don Quichotte de l'histoire, à la recherche de la grande réforme mondiale, — pour ne rapporter de ces voyages autre chose que quelque œil poché.
Les rapports de pauvre à riche, comme base sociale du socialisme, le « principe » coopératif comme son contenu, la « distribution plus juste » comme son but et l'idée de la justice comme son unique légitimation historique, voilà ce que l'on nous propose.
Avec combien plus de force, avec combien plus d'esprit, avec, combien plus d'éclat cette sorte de socialisme fut défendue par Weitling, il y a cinquante ans ! Il est vrai que et; tailleur génial ne connaissait pas encore le socialisme scientifique. Et si aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, toute sa conception déchirée en petits morceaux par Marx et Engels a été de nouveau heureusement apiécéc et recousue pour être soumise au prolétariat allemand comme le dernier mot de la science, il a fallu pour ce travail un tailleur..., mais pas un tailleur génial !
De même que les syndicats et les coopératives en sont le point d'appui économique, de même la principale condition politique de la théorie de Bernstein est le développement continuellement progressif de la démocratie. Les explosions présentes de la réaction ne sont pour lui que des « spasmes » qu'il tient pour fortuits et passagers, et avec lesquels on n'a pas à compter, lorsque l'on pose la directive générale de la lutte ouvrière.
Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que Bernstein pense en se fondant sur les assurances orales et écrites de ses amis sur la durée de la réaction, mais c'est le rapport objectif interne entre la démocratie et le développement social réel.
D'après Bernstein, la démocratie apparaît comme une phase inévitable dans le développement de la société moderne. La démocratie est même pour lui, tout comme pour un théoricien quelconque du libéralisme, la grande loi fondamentale du développement historique en général. C'est à sa réalisation que doivent servir toutes les forces agissantes de la vie politique. Ce principe, sous cette forme absolue, est foncièrement faux ; ce n'est qu'une schématisation petite-bourgeoise et superficielle des résultats d'une courte période de l'évolution bourgeoise pendant les vingt-cinq à trente dernières années.
En effet, lorsqu'on regarde de plus près le développement de la démocratie dans l'histoire et en même temps l'histoire politique du capitalisme, on arrive à un résultat essentiellement différent.
Pour ce qui est du premier point, nous trouvons la démocratie dans les formes sociales les plus diverses : dans les sociétés communistes primitives ; dans les Etats antiques basées sur l'esclavage, dans les communes urbaines du Moyen-Age. De même on rencontre la monarchie liée aux conditions économiques les plus différentes. D'autre part, le capitalisme provoque à ses débuts—comme production marchande — une constitution purement démocratique dans les communes urbaines.
Plus tard, dans sa forme plus développée — comme manufacture — il trouve sa forme politique adéquate dans la monarchie absolue.
Enfin, il produit en France — au stade de l'économie industrielle développée — successivement la république. démocratique(1793), la monarchie absolue de Napoléon Ier, la monarchie aristocratique de la Restauration(1815-1830), la monarchie bourgeoise constitutionnelle de Louis-Philippe, puis de nouveau une République démocratique, puis la monarchie de Napoléon III, enfin la troisième République.
En Allemagne, l'unique institution vraiment démocratique, le suffrage universel, n'est pas une conquête du libéralisme bourgeois, mais un instrument qui a servi à l'unification du pays par la soudure des petits Etats, et qui n'a pas d'autre signification dans le développement de la bourgeoisie allemande ; laquelle se contente fort bien pour le reste d'une monarchie constitutionnelle à moitié féodale.
En Russie, le capitalisme prospère merveilleusement, sous l'absolutisme oriental, sans que la bourgeoisie ait l'air, pour le moment du moins, de désirer ardemment la démocratie.
En Autriche, le suffrage universel se montre en grande partie comme une ceinture de sauvetage pour la monarchie en perdition, et le peu de rapport qu'il a avec la démocratie proprement dite est prouvé par la puissance du paragraphe 14.
En Belgique enfin, la conquête démocratique du mouvement ouvrier, le suffrage universel, est indubitablement liée à la faiblesse du militarisme (donc à la position géographique et politique spéciale du pays), et avant tout ce n'est pas « un bout de démocratie » conquis par la bourgeoisie, mais contre la bourgeoisie.
La montée ininterrompue de la démocratie qui parait être pour Bernstein et pour le libéralisme bourgeois la grande loi fondamentale de l'histoire humaine ou tout m moins de l'histoire moderne, n'est donc, si on la regarde de plus près, qu'une construction en l'air. Il n'est pas possible d'établir une connexité absolue entre le développement du capitalisme et la démocratie.
La forme politique est chaque fois la résultante de tous les facteurs politiques intérieurs et extérieurs, et permet — dans ces limites — une extrême diversité, depuis la monarchie absolue jusqu'à la République démocratique.
Si donc après avoir ainsi dû rejeter de la société moderne la loi historique générale du développement de la démocratie, nous nous adressons à la phase actuelle de l'histoire de la bourgeoisie, nous voyons ici encore, dans la situation politique, des facteurs qui tendent non pas à la réalisation du schéma de Bernstein, mais plutôt, au contraire, à l'abandon par la société bourgeoise de toutes les conquêtes faites jusqu'à présent.
D'une part, les institutions démocratiques, et cela est d'une importance capitale, ont en grande partie épuisé leur rôle dans le développement de la bourgeoisie : autrefois nécessaires pour la réunion des petits Etats et pour la constitution des grandes nationalités modernes (Allemagne, Italie), elles sont devenues superflues.
Le développement économique a, depuis amené une « coalescence organique » entre les différentes parties, et les « bandages » de la démocratie politique peuvent être enlevés sans danger pour l'organisme des sociétés bourgeoises.
Les mêmes considérations valent pour la transformation en un mécanisme capitaliste du mécanisme féodal de toute la machine politico-administrative de l'Etat.
Cette transformation qui, au point de vue historique, a été indissolublement liée à la démocratie, s'est accomplie aujourd'hui dans une mesure telle que les « ingrédients » purement démocratiques de l'Etat ; le suffrage universel, la forme républicaine, peuvent être éliminés sans danger, sans que l'administration, les finances, la défense nationale retombent dans les formes d'avant 48.
Si donc à ce point de vue, le libéralisme est, pour la société bourgeoise, essentiellement superflu, à un autre point de vue non moins important il est devenu pour elle un obstacle immédiat. Ici il faut prendre surtout en considération deux facteurs, qui dominent toute la vie politique de l'Etat moderne : la politique mondiale et le mouvement ouvrier — qui ne sont que deux côtés différents de la phase actuelle du développement capitaliste.
Le développement de l'économie mondiale, l'accentuation et la généralisation de la concurrence sur le marché mondial ont fait du militarisme et du ce « marinisme » le moment déterminant de la vie intérieure et de la vie extérieure de tous les grands Etats. Mais si la politique mondiale et le militarisme présentent indubitablement — parce que liés aux besoins économiques du capitalisme, — une tendance ascendante de la phase actuelle, il en résulte logiquement que la démocratie bourgeoise doit suivre une marche descendante. — et nous en trouvons l'exemple le plus frappant dans les Etats-Unis depuis la guerre espagnole.
En France, la République doit surtout son existence à la situation politique internationale, qui rend une guerre momentanément impossible.
En Allemagne, l'ère récente des « grands armements » et la politique mondiale inaugurée à Kiau-Tchéou a été immédiatement payée par deux sacrifices de la démocratie bourgeoise, la décomposition du libéralisme et la défaillance du centre catholique.
Si donc la politique extérieure de la bourgeoisie la pousse dans les bras de la réaction, il en est de même de sa politique intérieure — déterminée par l'ascension de la classe ouvrière. Bernstein lui même le reconnaît en rendant responsable de la désertion de la bourgeoisie; libérable la légende de l'Ogre démocrate socialiste, c'est-à-dire les tendances socialistes de la classe ouvrière, et c'est pour celte raison qu'il conseille au prolétariat d'abandonner son but final, afin de tirer du terrier réactionnaire le libéralisme effrayé jusqu'à la mort.
Mais avec cela, il prouve de la façon la plus frappante — en faisant aujourd'hui du rejet du mouvement ouvrier socialiste la condition vitale et la «présupposition » sociale de la démocratie bourgeoise —, que cette démocratie est contradictoire au développement de la tendance intérieure de l'évolution de la société bourgeoise et dans la même mesure que le mouvement ouvrier est le produit direct de cette tendance.
Mais il prouve encore autre chose. En faisant de l'abandon par la classe ouvrière du but final socialiste, la condition et la présupposition de la résurrection de la démocratie bourgeoise, il montre combien peu au contraire la démocratie bourgeoise peut être une condition et une présupposition nécessaire du mouvement socialiste et de sa victoire.
Ici, le raisonnement de Bernstein aboutit à un cercle vicieux, sa dernière conclusion détruisant sa première supposition.
Le moyen de sortir de ce cercle est très facile ; du fait que le libéralisme bourgeois a rendu l'âme, par peur du mouvement ouvrier ascendant et de son but final, il ne résulte que ceci : c'est que le mouvement ouvrier peut être et est aujourd'hui l’unique soutien de la démocratie ; que le sort du mouvement socialiste n'est pas lié à la démocratie bourgeoise, mais au contraire que le sort de la démocratie est lié au mouvement socialiste ; que la démocratie n'acquiert jias d'autant plus de vitalité que la classe ouvrière abandonne plus la lutte pour son émancipation, mais au contraire qu'elle en acquiert dans la mesure où le mouvement socialiste devient assez fort pour combattre les conséquences réactionnaires delà politique mondiale et de la désertion de la bourgeoisie; que quiconque désire le renforcement de la démocratie doit aussi désirer le renforcement—et non pas l'affaiblissement— du mouvement socialiste ; enfin qu'en abandonnant les tendances socialistes, on abandonne en même temps la démocratie.
Bernstein déclare à la fin de sa « réponse » à Kautsky dans le Vorwaerts qu'il est complètement d'accord avec la partie pratique du programme de la démocratie socialiste et que s'il a quelque objection à faire, c'est uniquement contre la partie théorique. Malgré tout cela il croit encore pouvoir marcher à bon droit dans les rangs du Parti, « car, pour lui, quelle importance y a-t-il, à ce que dans la partie théorique il y ait une phrase qui ne soit pas à l'unisson de sa conception? » Cette déclaration prouve tout au plus combien Bernstein a perdu le sens de la connexité entre l'action pratique de la démocratie socialiste et ses principes généraux, combien les mêmes mots ont cessé d'exprimer les mêmes choses pour le « Parti » et pour « Bernstein ». En réalité, les théories propres à Bernstein conduisent à cette conception socialiste très élémentaire que, sans les principes fondamentaux, toute la lutte pratique devient inutile et sans valeur, qu'avec l'abandon du but final le mouvement lui-même doit sombrer.
ROSA LUXEMBURG
(Traduit par J. Rivière)
(1) Voir sur la même question les numéros 0, 7 et 8 du Mouvement socialiste.
(2) Nous reproduisons le passage auquel Rosa Luxemburg l'ait allusion :
« L'onction principale des syndicats (et personne ne l'a mieux prouvé que Bernstein lui-même, il y a sept ans, dans la Neue Zeit) consiste en ce qu'ils fournissent aux ouvriers le moyen de réaliser la loi capitaliste des salaires, c'est-à-dire la vente de la force de travail d'après la situation du marché. Ce en quoi les syndicats servent au prolétariat, c'est qu'ils lui permettent de tirer profit des conjonctures du marché à chaque moment donné. Mais ces conjonctures elles-mêmes, c'est-à-dire d'une part la demande de la force de travail déterminée par l'état de la production, et d'autre part l'offre de cette force de travail conditionnée par la prolétarisation et par la reproduction naturelle, et enfin le degré donné de la productivité du travail, — tout cela se trouve en dehors de la sphère d'action des syndicats. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas renverser la loi des salaires. Ils peuvent tout au plus replacer l'exploitation capitaliste dans ses limites « normales », mais en aucun cas supprimer progressivement cette exploitation capitaliste elle-même.
« Conrad Schmidt, il est vrai, traite le mouvement syndicat présent de « stade initial faible », et il annonce qu'à l'avenir « le syndicalisme exercera une influence croissante sur la production elle-même ». Mais on ne peut comprendre que deux choses sous ce mot « réglementation de la production » : 1° l'intervention dans la technique du processus de production; 2° la détermination de l'étendue de la production. Quelle peut être, sur ces deux questions, la nature de l'action des syndicats? Il est évident que, pour ce qui est de la technique de la production, l'intérêt d'un capitaliste pris individuellement se confond complètement avec le progrès et le développement de l'économie capitaliste. Ce sont ses propres besoins qui le poussent aux améliorations techniques. Mais la situation d'un ouvrier pris individuellement est précis sèment tout à fait le contraire; toute amélioration technique est en opposition avec les intérêts des ouvriers, qui en sont atteints directement, et empire leur situation immédiate, en dépréciant la valeur de la force de travail. En tant que le syndical peut intervenir dans la technique de la production, il ne peut le faire que dans le sens que nous venons d'indiquer, c'est-à-dire agir dans l'intérêt du groupe d'ouvriers directement intéressé, en s'opposant à toutes les innovations. Or, dans ce cas, il n'agit pas dans l'intérêt de la classe ouvrière prise dans son ensemble et dans le sens de son émancipation, — lesquels concordent plutôt avec le progrès technique, c'est-à-dire avec- l'intérêt d'un capitaliste pris individuellement; — mais précisément dans le sens contraire, dans le sens de la réaction. Et, en effet, nous trouvons celle tendance d'agir sur la technique de la production, non pas dans l'avenir, où la cherche Conrad Schmidt, mais dans le passé du mouvement syndical : elle est ta marque caractéristique de l'ancienne phase du trade-unionisme anglais (jusqu'en 1860 environ), pendant laquelle il se rattachait encore aux traditions des corporations du Moyen-Age, et s'appuyait d'une façon caractéristique sur le principe suranné « du droit acquis à un travail convenable ».
« Par contre, la tendance des syndicats à déterminer l'étendue de la production et les prix des marchandises est un phénomène de date tout à fait récente. Ce n'est que tout dernièrement que nous avons vu (de nouveau en Angleterre seulement) surgir des tentatives dirigées dans ce sens.
« Mais aussi bien, pour ce qui est de leur caractère et de leurs tendances, ces tentatives valent celles qui précèdent. Car en somme à quoi se réduit nécessairement la participation active des syndicats dans la détermination de l'étendue et des prix de la production marchande? — A un cartel des ouvriers et des patrons contre le consommateur, — et notamment en employant à l'égard des patrons en concurrence des mesures de compression qui ne cèdent en rien aux méthodes employées par les syndicats patronaux réglementaires. Ce n'est plus en fait une lutte entre le travail et le capital, mais une lutte solidaire du capital et du travail contre les consommateurs. Au point de vue de sa valeur sociale, c'est une entreprise réactionnaire qui ne peut devenir une étape clans la lutte que le prolétariat mène pour son émancipation, pour la raison qu'elle représente plutôt le contraire de la lutte des classes. Au point de vue de sa valeur pratique;, c'est une utopie qui, comme quelques instants de réflexion doivent le faire voir, ne pourra jamais s'étendre, à des branches de production d'une certaine importance; et produisant pour le marché mondial. « L'activité des syndicats si; borne donc essentiellement à la lutte pour le salaire et pour la réduction de la journée de travail, c'est-à-dire à la simple, réglementation de l'exploitation capitaliste d'après la situation du marché; l'action sur le processus de production leur est fermée par la nature même des choses. Plus encore. Toute la marche du développement syndical tend précisément, à l'encontre de ce que dit Conrad Schmidt, à supprimer complètement tout rapport immédiat entre le marché du travail et le reste du marché. Le fait le plus significatif, à ce sujet, c'est même la tendance de mettre le contrat de travail au moins en rapport passif avec la situation générale de la production, à l'aide du système de l'échelle mobile, qui est actuellement complètement dépassé par l'évolution, et dont les trades-unions anglaises se détournent de plus en plus. »
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57372256/f3.item#
https://bataillesocialiste.wordpress.com/2012/06/01/democratie-industrielle-et-democratie-politique-rosa-luxemburg-1899/
https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2012/06/rosa1899.pdf


/image%2F1507914%2F20210104%2Fob_4eb7c7_le-mouvement-socialiste-revue.jpeg)
/image%2F1507914%2F20210104%2Fob_99e891_le-mouvement-socialiste-revue.jpeg)


/image%2F1507914%2F20210427%2Fob_183062_semainesanglante3.jpg)
/image%2F1507914%2F20210502%2Fob_35e275_akg915720.jpg)
/image%2F1507914%2F20210502%2Fob_0323f9_le-socialisme-en-france.jpg)
/image%2F1507914%2F20210410%2Fob_2adadf_limoges-1905.jpg)
/image%2F1507914%2F20210410%2Fob_ac6b5f_limoges-barricades.jpg)
/image%2F1507914%2F20210410%2Fob_829766_large.jpg)
/image%2F1507914%2F20210410%2Fob_ebf8bf_1-manifestationlimoges-17-avril-ac582.jpg)
/image%2F1507914%2F20210410%2Fob_5bb217_beaulieugendarmes.jpg)
/image%2F1507914%2F20210410%2Fob_7c66e1_greve-limoges-1.jpg)
/image%2F1507914%2F20210410%2Fob_a2b2c1_le-socialisme-en-france.jpg)

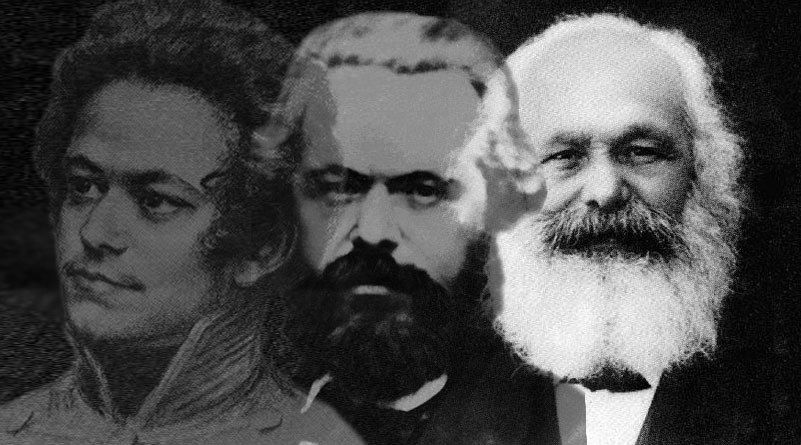



/idata%2F1495971%2Ftardi%2Ftardi4.jpg)
/idata%2F1495971%2FIls-l-ont-accompagn--e%2Fliebk.jpg)
/idata%2F1495971%2Fpolitique-coloniale%2F450px-World_1898_empires_colonies_territory.png)
/idata%2F1495971%2FRosa-Luxemburg%2Funterwegs.jpg)